Éditions Le bruit des autres, 2010.
Gravure de couverture : Jacques Gruet.
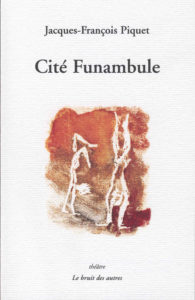
Pour l’écriture de cette pièce, l’auteur a reçu une bourse d’aide à la création du CNL en 2007. Le texte a été terminé en octobre 2008 lors d’une résidence au Centre des écritures dramatiques de la Chartreuse de Villeneuve-lès-Avignon.
Cité Funambule a été sélectionnée sur manuscrit pour la 9e édition du festival Actuelles des écritures dramatiques contemporaines qui s’est déroulée du 10 au 14 novembre 2009 au Taps de Strasbourg (directeur de lecture : Étienne Bayart).
Notes de travail 2007-2009
La pièce est écrite pour sept comédiens dont certains cumulent deux ou trois rôles. Elle se décline sur quatre actes respectivement intitulé Printemps, Eté, Automne, Hiver, introduisant ainsi la notion de cycle et soulignant le caractère répétitif de la vie dans la Cité Funambule ; l’absence d’indices spatio-temporels induit en outre l’idée que la Cité Funambule se situe « ailleurs » et hors du temps. La description qui en est donnée renforce cette idée puisque il y est dit que les pavillons qu’elle abrite portent chacun le nom d’une étoile et que ceux qui y résident sont désignés par leur prénom accolé au nom de leur lieu de vie. Si ces derniers y gagnent une particule nobiliaire qui leur confère une certaine dignité, ils y perdent en revanche le premier des signes de reconnaissance qu’est le patronyme.
En début de texte, il est dit que la Cité Funambule « abrite des individus de tous âges et de tous milieux qui ont en commun d’avoir un jour chuté » et cela peut l’assimiler à un hôpital psychiatrique. Il serait toutefois réducteur de s’en tenir là, car l’endroit peut être pareillement métaphorique ou microcosmique de bon nombre de nos sociétés actuelles, voire de la planète toute entière où des milliers d’individus chutent quotidiennement au bas de l’échelle sociale, sous le seuil de la pauvreté, au-delà des limites de la dignité humaine, où la folie trouve à s’épanouir dans la violence, la cupidité et la bêtise. Si l’on s’en tient néanmoins à l’idée d’une Cité Funambule asile psychiatrique, il n’est pas anodin de rappeler qu’encore au XIXe siècle, les gens bien se rendaient en famille à Bicêtre ou à la Salpetrière pour y voir les fous et les folles, et que le « spectacle » était payant !
Trois personnages récurrents : le guide, le gérant général et la femme de ménage ; tous trois travaillent à la Cité Funambule mais n’y résident pas, encore qu’on n’en sache rien pour les deux derniers ; en tout cas, aucun d’entre eux ne se considère comme Funambule. Contrairement à ces derniers, on ne les désigne jamais ni par leur prénom ni par leur nom, mais par leur fonction.
Une douzaine d’autres personnages occupe la scène plus ou moins longtemps. Parmi eux six Funambules porteurs de la seule histoire qui compte à leurs yeux, à savoir celle de la chute qui les a conduits à la Cité Funambule. Aucun ne se raconte de la même manière, car tous n’ont pas la même maîtrise ou le même rapport au langage : quand l’un en joue pour se dire par le biais d’un récit romanesque, un autre doit recourir à un interprète car il en a perdu l’usage.
Sur les trois personnages récurrents, le guide est sans conteste celui qui tient le rôle le plus important en terme de présence et pour ce qu’il incarne. Son travail consiste à faire visiter la Cité Funambule à un groupe de visiteurs, lesquels ne sont pas tant intéressés par les bâtiments ou le parc arboré que par les résidents eux-mêmes, ou plutôt par l’idée qu’ils se font d’individus « qui ont un jour chuté ». Toutefois, il n’y a là rien de « spectaculaire » d’où un certain décalage entre les attentes des uns et la réalité des autres, réalité qui est tout – détresse intérieure, dérèglement des sens, mal-être, etc. – sauf « spectaculaire ». Ce décalage fait que guide et visiteurs ne sont jamais au bon endroit au bon moment, comme s’ils ne savaient ou ne pouvaient pas voir cette réalité ou comme si elle se dérobait à eux. Seul le public dans la salle y a droit, ce qui nous ramène au théâtre en signifiant que la réalité pour les uns fait spectacle pour les autres.
La scène finale à laquelle guide et visiteurs sont conviés – à savoir la scène du bal de fin d’hiver – est spectaculaire mais davantage onirique et poétique que représentative d’une quelconque réalité. De plus ils y assistent en voyeurs et non en spectateurs : le guide n’a-t-il pas posé comme condition préalable de « ne plus être », autrement dit de se départir de son identité de visiteur ?
Le personnage du guide présente une nuance de personnalité selon qu’il est incarné par un homme ou par une femme (le texte prévoit les deux cas de figure) mais s’avère plus proche des Funambules qu’il ne le paraît de prime abord. Le monologue masculin à l’acte II met l’accent sur le mensonge : le guide vend un spectacle qu’il ne peut montrer, pire qui n’existe pas. Or, après avoir assisté à une séance de psychanalyse grand-guignolesque, il découvre que les syllabes inversées de son prénom forment l’injonction : Sois franc ! Ce qui le place en porte-à-faux avec lui-même, situation pour le moins inconfortable et propice à le faire chuter… En ce qui concerne le guide féminin, l’accent est mis sur l’attente (« Des années qu’elle attend, la petite guide, et elle savait même pas que c’était programmé dans son prénom ! ») et en cela ressemble aux Funambules dont la vie n’est qu’attente.
Le gérant général affiche pour les arbres du parc une passion qui tient de la maniaquerie. Il connaît mieux les noms de ces derniers que ceux des résidents qui vivent à la Cité Funambule. Comme tous les maniaques, il est capable de s’emporter et de se comporter de manière violente dès lors que l’objet de sa passion est en cause : n’abat-il pas un oiseau pour la seule raison que celui-ci « abîmait » un arbre avec son bec ? Son lyrisme « vert » est caricatural du poète romantique et accuse sa relative indifférence envers les humains dont il a la charge, à tout le moins administrative. Son désir de familiarité tant avec le guide qu’avec la femme de ménage (« Appelez-moi Gégé ») traduit le besoin d’être aimé et le rend quelque peu pathétique dans ses vaines tentatives pour y parvenir. Que le/la guide à l’acte 4 réponde à ce désir laisse entendre que ces deux-là se sont reconnus.
La femme de ménage est un être simple et de bon sens qui vient de nulle part et n’a aucune ambition d’aller quelque part, qui de plus est lucide quant à ses capacités intellectuelles. En disant ne faire que répéter ce qu’elle entend des uns et des autres sans toujours comprendre, elle se dispense de penser par elle-même. Ainsi, à la manière du bouffon ou fou du roi, elle ose quelques répliques dont la portée littéraire ou philosophique est censée lui échapper.
Coupures de presse
« Ce texte très métaphorique agit comme un révélateur photo des souffrances humaines, enfouies, dissimulées un temps et qui parfois émergent pour envahir le présent. Plusieurs personnages racontent leurs fêlures. (…) Jacques-François Piquet poursuit sa recherche, par l’intermédiaire de la dramaturgie, sur les fonctionnements humains comme il l’avait déjà fait dans Qui d’autre ? Son approche est différente mais tout aussi essentielle. »
Brigitte AUBONNET
Encres Vagabondes, septembre 2010.
« Avec cette pièce en quatre actes, Jacques-François Piquet poursuit sa réflexion sur la maladie mentale, l’instrumentalisation des patients et les limites de l’institution psychiatrique. L’humour n’est pas absent bien que le sujet soit grave. C’est bouleversant et la distanciation évidente permet au lecteur, comme au spectateur, de n’être dupe de rien et de réfléchir. Un théâtre pour réfléchir, c’est rare et à ne pas manquer… »
Lucien WASSELIN
La tribune minière, janvier 2011.
« La matière humaine de cette pièce en quatre actes, un pour chaque saison, est la même que celle des Portraits soignés, parus l’an dernier chez Rhubarbe : la vie et la presque absence d’histoires dans cet ailleurs qui pourrait être asilaire mais aussi bien représenter la face sombre de notre propre monde. Et c’est un premier sujet d’intérêt pour qui a lu les deux ouvrages que de voir comment la nature du texte, là récits, ici théâtre, détermine la narration. Le théâtre ne peut guère se passer de mots. Or les mots pour le dire, pour se dire, c’est précisément ce qui manque à la plupart des résidents, à commencer par leur propre nom, réduit à un simple prénom accolé au lieu de séjour, Yan d’Achernar, Jacques de Ferkad… L’auteur use alors de médiateurs, une psychologue inquisitrice, un traducteur improvisé d’une parole inintelligible et même, un résident écrivain, parole distanciée par excellence. Ajouté à cela, comme dans l’Illusion comique de Corneille, la distance du théâtre dans le théâtre car la vie de la Cité funambule est objet de spectacle pour des visiteurs qu’un guide promène sur scène, leur indiquant les cas particulièrement remarquables. Sans avoir l’air d’y toucher, Piquet met sous une lumière implacable l’horreur de l’enfermement, de l’attente sans objet, du temps qui finit toujours par passer, lui, à défaut du bus fantasmé qui permettrait de quitter l’endroit. Enfin, qui passe, c’est à voir : quoi de plus clos que le cycle des saisons ? Il y a du Dario Fo ou du Franca Rame dans ce Piquet là : c’est cru ET pudique, farce ET noir, désespéré ET pleurant d’humanité. »
Alain KEWES
Revue Décharge n° 146, mai 2010.